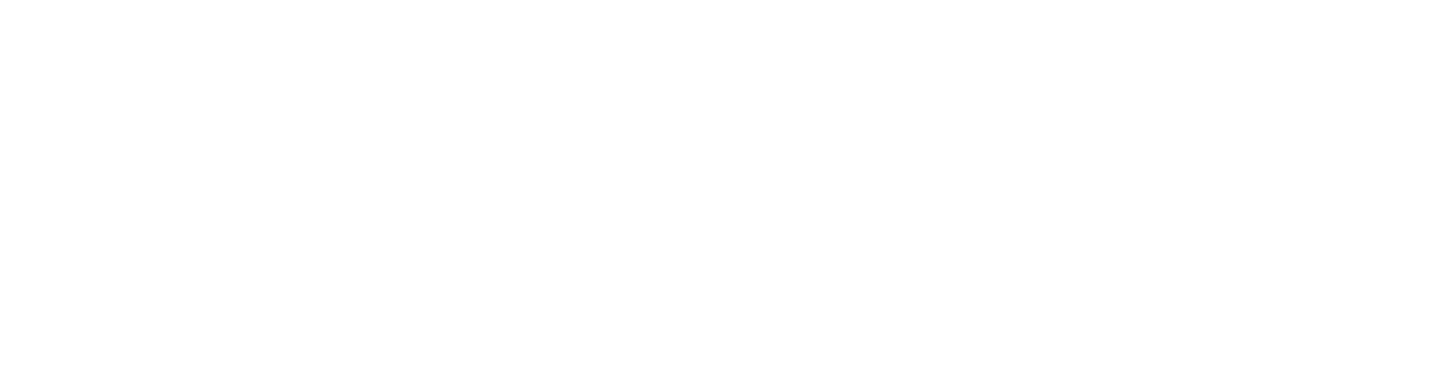Les redressements URSSAF restent fréquents et peuvent s’avérer particulièrement coûteux, y compris au sein de grand groupes dotés de dispositifs internes censés être efficaces. Notre expérience démontre qu’une part significative de ces redressements pourrait être évitée par une meilleure sensibilisation des employeurs et un contrôle rigoureux de certaines pratiques à risque.
Voici un panorama des chefs de redressement les plus couramment constatés lors des contrôles URSSAF, ainsi que des leviers efficaces à mobiliser pour limiter votre exposition.
Avantage en nature véhicule et carte carburant : un risque classique mais évitable
L’avantage en nature lié à l’usage d’un véhicule de fonction demeure l’un des postes les plus fréquemment redressés.
L’utilisation des cartes carburant, en particulier, conduit souvent à une mauvaise évaluation de l’avantage en nature. Lorsque l’employeur prend en charge le carburant utilisé à des fins personnelles, l’avantage est évalué forfaitairement à 67 % du coût annuel pour les véhicules en location (ou 20 % en cas d’achat). Si le salarié prend en charge le carburant à titre personnel, ces taux sont réduits à 50 % (ou 15 % en cas d’achat).
Beaucoup d’employeurs appliquent ces taux réduits en s’appuyant sur une clause contractuelle interdisant l’usage privé de la carte carburant. Or, cette interdiction ne suffit pas. En matière de cotisations sociales, la charge de la preuve repose sur l’employeur. Sans preuve concrète de la prise en charge effective du carburant par le salarié pour ses trajets privés, un redressement est quasi systématique.
Pour éviter un redressement, il est conseillé de :
- tenir un carnet de bord distinguant les kilomètres professionnels des trajets privés,
- mettre en place un dispositif de contrôle assorti de sanctions en cas d’usage non conforme.
Indemnités transactionnelles : la rédaction du protocole est déterminante
Les indemnités transactionnelles peuvent, sous conditions, être exonérées de cotisations sociales.
L’exonération ne soulève pas de difficulté particulière lorsque l’indemnité est versée à l’issue d’un licenciement et que son montant, cumulé à celui de l’indemnité de licenciement, reste en deçà des plafonds d’exonération prévus par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
En dehors de ce cadre, la Cour de cassation admet que l’indemnité transactionnelle puisse être exonérée dès lors que l’employeur démontre qu’elle répare un préjudice (Cass. 2e civ. 15 mars 2018, n° 17-10.325 ; n° 17-11.336 ; Cass. 2e civ., 13 octobre 2022, n° 21-10.175).
Un arrêt plus récent a validé l’exonération d’une indemnité ayant pour objet de réparer des préjudices moraux et professionnels liés aux conditions d’exercice des fonctions (Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, n° 22-18.333, FS-B).
La pratique montre cependant que de nombreux employeurs échouent à justifier le caractère indemnitaire de ces sommes, faute d’une rédaction rigoureuse du protocole et de preuves tangibles.
Pour éviter un redressement, il est conseillé de:
- personnaliser chaque protocole et éviter les modèles standard,
- décrire clairement le préjudice indemnisé dans le préambule,
- conserver tous les éléments de preuve (plaintes du salarié, témoignages, certificats médicaux, etc.).
Séminaires d’entreprise et voyages de cohésion : des conditions strictes à respecter
Nombreux sont les employeurs qui récompensent et fidélisent leurs salariés en organisant des séminaires aux sports d’hiver ou dans une destination de rêve au soleil.
Attention car les dépenses engagées à ce titre sont systématiquement considérées comme des avantages devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale par les inspecteurs URSSAF.
L’argument consistant à soutenir que ces séjours ont pour objet de renforcer la cohésion d’équipe et qu’ils sont donc organisés dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’entreprise ne suffit généralement à justifier la qualification de frais professionnels et leur exclusion corrélative de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Seule la caractérisation d’un temps de travail permet d’échapper à la qualification d’avantage en nature et au redressement. A cet égard, selon une jurisprudence constante, un voyage est requalifié en avantage si les temps de travail sont marginaux (Cass. 2e civ. 20 mars 2008, n° 07-12.797 ; Cass. 2e civ. 30 mars 2017, n° 16-12.132).
Pour éviter un redressement, il est conseillé de :
- construire un programme de travail structuré,
- adresser ce programme aux participants,
- veiller à ce que les temps d’activité professionnelle représentent au moins 50 % du séjour.
Indemnités de panier : ne pas négliger la preuve des déplacements
Versées dans de nombreux secteurs d’activité (notamment le BTP, le transport routier, la propreté ou encore la maintenance industrielle) les indemnités de panier sont destinées à compenser les frais de repas exposés par les salariés contraints de prendre leur repas hors de leur domicile ou de leur lieu habituel de travail.
Le versement de ces indemnités est la plupart du temps obligatoire en application des conventions collectives de branche.
Toutefois, la seule circonstance que l’indemnité doive être obligatoirement versée en application de la convention collective de branche ou d’un accord d’entreprise ne suffit pas à justifier l’exclusion de cette indemnité de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Les indemnités de repas ne sont exonérées que si deux conditions cumulatives sont remplies :
- le salarié est en situation de déplacement effectif,
- il ne peut regagner ni son domicile ni son lieu habituel de travail pour le repas.
Si les inspecteurs sont peu regardants sur les indemnités versées aux ouvriers affectés sur des chantiers, ils sont beaucoup plus exigeants pour des salariés occupant des fonctions qui sont en partie sédentaire (Conducteurs de travaux ou Chefs de projet par exemple).
Par ailleurs, si le site du client ou le chantier d’affectation est proche du lieu habituel de travail ou du domicile du salarié (moins de 10 km), les inspecteurs réintègrent les indemnités de panier dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dès lors qu’ils considèrent que les salariés sont en mesure de rentrer à leur domicile ou sur leur lieu de travail habituel.
Pour éviter un redressement, il est conseillé de :
- pour les salariés dont les missions sont en partie sédentaires : documenter la réalité des déplacements des salariés en étant capable de fournir non seulement les lettres d’affectation et/ou de mission, mais aussi les relevés de pointages permettant de démontrer la présence effective du salarié sur le chantier ou le lieu de mission pendant un temps voisin de la pause déjeuner,
- pour les lieux de mission situés à proximité du lieu habituel de travail ou du domicile : démontrer que les conditions de travail du salarié ne lui donnent pas la possibilité de rentrer chez lui ou sur son lieu habituel de travail pour le déjeuner (travail en continu, temps de pause raccourci en raison des contraintes du chantier, etc.).
Frais de restauration : conditions strictes pour l’exonération
La prise en charge des frais de repas pris au restaurant par des salariés de l’entreprise peut, dans certaines situations, être exclue de l’assiette des cotisations sociales au titre des frais professionnels. Cette exonération n’est cependant pas systématique.
Ainsi, les frais de restaurant engagés par les salariés qui ne sont pas en déplacement professionnel, dans des établissements situés à proximité de leur lieu habituel de travail ou de leur domicile lorsqu’ils sont en télétravail n’ont pas la nature de frais professionnels.
En dehors de la situation de déplacement professionnel, seuls les repas d’affaires peuvent être considérés comme des frais professionnels déductibles.
Attention à la preuve. Il ne suffit pas, en effet, de produire un ticket de caisse ou une note de frais pour faire obstacle au redressement. L’URSSAF exige que l’employeur soit en mesure de démontrer le caractère strictement professionnel de la dépense engagée, ce qui implique de justifier les circonstances dans lesquelles le repas a été pris.
Ainsi, en matière de repas d’affaires, il est impératif de pouvoir identifier :
- les participants (nom, prénom, fonction),
- leur lien avec l’activité de l’entreprise (clients existants ou potentiels, partenaires commerciaux, etc.),
- et la finalité professionnelle du repas.
Pour réduire le risque de redressement, il est conseillé :
- de formaliser une politique interne claire sur les conditions de remboursement des frais de restauration,
- de sensibiliser les salariés à l’importance de fournir des justificatifs complets : date, objet de la mission, lieu d’intervention, nom du client ou du partenaire, etc.
- et d’utiliser, si possible, des outils numériques de GTA pour tracer ces informations de manière fiable et conforme.
Indemnités kilométriques : les justificatifs sont indispensables
Le remboursement des frais kilométriques engagés par un salarié utilisant son véhicule personnel dans le cadre de ses missions professionnelles peut, sous certaines conditions, être exonéré de cotisations sociales. Cette exonération repose principalement sur l'application du barème fiscal des indemnités kilométriques, mis à jour chaque année par l'administration.
Ce barème, qui couvre les véhicules dont la puissance fiscale est comprise entre 3 et 7 CV, est également admis en matière sociale, sous réserve que le remboursement respecte strictement les conditions d’éxonération fixées par l’URSSAF.
Or, en pratique, les indemnités kilométriques figurent parmi les postes de frais professionnels les plus fréquemment réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales à l’issue d’un contrôle.
En effet, pour l’URSSAF le versement d’indemnités kilométriques sur simple présentation d’un tableau récapitulatif ou d’un estimatif mensuel ne suffit pas à établir leur caractère professionnel.
En l’absence de justificatifs détaillés, l’URSSAF est fondée à requalifier ces sommes en complément de rémunération.
Lors d’un contrôle, l’employeur doit être en mesure de démontrer :
- l’effectivité des déplacements,
- leur caractère professionnel,
- et le kilométrage exact parcouru, salarié par salarié, mois par mois.
Pour sécuriser le traitement de ces remboursements, il est fortement recommandé de mettre en place un processus interne formalisé, incluant une politique de frais professionnels claire et documentée, ainsi que des formulaires de demande détaillés. Chaque demande d’indemnité kilométrique devrait comporter au minimum les informations suivantes :
- la date du déplacement,
- le motif de la mission (clientèle, rendez-vous professionnel, intervention sur site…),
- le lieu de départ et le lieu d’arrivée,
- le nom et l’adresse du client ou du partenaire visité,
- le nombre de kilomètres parcourus (à l’aller et au retour),
- la puissance fiscale du véhicule utilisé, justifiée par une copie de la carte grise.
Pour conclure
Un contrôle URSSAF ne se limite pas à une vérification comptable : il implique une analyse juridique rigoureuse des pratiques RH et exige une documentation irréprochable. Les principaux chefs de redressement peuvent être évités par une anticipation rigoureuse et une justification fondée en droit.
Mon cabinet vous accompagne à chaque étape de votre contrôle Urssaf :
- audit préventif de conformité,
- assistance dans la rédaction de vos documents (transactions, politiques de frais, etc.),
- assistance et conseil en cas de contrôle,
- défense devant le commission de recours amiable et le pôle social du Tribunal judiciaire.
Chaque action compte pour prévenir un redressement ou en limiter les conséquences.